Qu'Ennismore ne soit plus disponible (si ce n'est via un import japonais particulièrement onéreux) est un scandale - et ce n'est pas une façon de parler. Les rééditions de toutes sortes se multiplient, et il n'est personne pour rendre hommage à Colin Blunstone, homme aussi intègre humainement parlant qu'artistiquement ? J'avais évoqué Parachute dans ma notice sur SF Sorrow, mais je lui avais pas consacré de notice séparée. Cette injustice devait être réparée : Parachute est en effet là pour nous rappeler combien les Pretty Things furent grands dans les années 67-70... Je suis tombé sur un article intitulé « The Puzzle of Brian Wilson’s SMILE » qui m’a beaucoup intéressé. Il y est question des « feels » (ainsi que Brian les avait nommés dans une interview), ces fragments que Brian composait au piano, essentiellement en 66. Beaucoup d'images d'Amérique en tête après avoir relu l'Absalon, Absalon ! de Faulkner : les grands espaces (ceux des westerns de Walsh), les espaces restreints propices, a contrario, à l'introspection (comme la cabane où Townes van Zandt passa une partie de son temps)... Ca m'a rappelé que celui qui avait mythifié l'histoire de l'Amérique avec le plus de démesure, c'était peut-être bien Brian Wilson dans son Smile. En observant quelques groupes locaux, je m'étonne de l'importance aujourd'hui accordée au style. On n'a pas idée des efforts qui sont déployés par certains pour s'inventer une niche... Il est d'usage de considérer que Waiting for the Sun, album de la désillusion ("Summer's Almost Gone"), marque aussi un certain affaissement musical. Une lecture de la notule que Michka Assayas consacre aux Doors dans son (par ailleurs excellent) Dictionnaire du rock suffit à le confirmer : "disque moins intense", "Morrison se fait volontiers crooner"... Après d'innombrables écoutes des disques des Auteurs, j'en arrive à m'interroger sur moi-même : est-ce moi qui ne vais pas, qui tombe dans la complaisance... ou est-ce que Luke Haines ne ratait aucune chanson à l'époque des Auteurs ? Ce qui a suivi New Wave ne me paraît pas moins bon : Haines se débrouille toujours pour accrocher l'oreille, et les paroles sont évidemment d'un niveau supérieur à la moyenne (sens de la formule, bizarrerie : voir par exemple "Unsolved Child Murder" sur After Murder Park). Dans la famille du punk new-yorkais, je demande le père. Non pas le grand ancètre (Johnny Thunders) ni le rejeton sophistiqué (Tom Verlaine), mais le père : Richard Meyers, dit Richard Hell. Car celui-ci, outre qu'il a incarné mieux que quiconque le punk new-yorkais, a su écrire des hymnes à la jeunesse et à la liberté qui ont résisté aux assauts du temps (là où tant de groupes punk apparaissent aujourd'hui inécoutables). Me reviennent à l'esprit, en cette période hivernale (avec le soleil qui s'éteint plus vite tous les jours), les magnifiques textures orchestrales que Mercury Rev avait déposées sur les plus belles plages de son Deserter's Songs. Si jamais musique a été appropriée à illustrer des fantaisies, à accompagner des films sur l'enfance (dans le genre de La Cité des enfants perdus), c'est bien celle-ci. D'ailleurs, les enregistrements de Mercury Rev, au tout début de l'histoire du groupe étaient destinés à accompagner des films réalisés par des amis...
Blunstone, rappelons-le, avait fourni avec ses complices des Zombies un des quelques albums qui doivent figurer dans toute discothèque qui se respecte, Odessey & Oracle. Ce disque-chant du cygne avait été sans suite, du fait de la séparation prématurée des Zombies ; mais la carrière de Blunstone allait lui apporter un appréciable codicille. One Year, sorti en 1971, s'attira les louanges des critiques. Certains se demandent d'ailleurs encore quel est le meilleur album solo de Blunstone... Je tiens pour ma part, et sans hésitation, Ennismore (1973) pour son véritable chef-d'oeuvre.
A l'occasion d'Ennismore, Blunstone s'entourera à nouveau de ses ex-acolytes, Rod Argent et Chris White, tous deux crédités de la production. Le résultat : Ennismore est un miracle de délicatesse, ce qui n'est pas sans surprendre quand on sait qu'il est sorti en pleine apogée du glam et de la musique progressive. La pochette, loin de toute grandiloquence, représente Blunstone au recto et des arbres noyés de brume au verso. Si Argent et White sont venus aider leur vieux pote, ils n'ont pas pour autant eu un rôle prépondérant dans le songwriting : la seule composition attribuée à Argent et White est "Andorra" (un assez beau morceau de pop, avec basse sautillante et rythmique proche du reggae ; le titre est significatif, par ailleurs, puisqu'on a droit à des guitares hispaniques et de brèves castagnettes) ; Blunstone, lui, a écrit ou coécrit neuf des onze titres de l'album (ce qu'il ne faisait pas à l'époque des Zombies). Ennismore est à son image : tendre et presque anachronique. Rien à voir avec le soft-jazz que produira Rob Argent avec son groupe à la fin des années 70...
Lors d'une première écoute, les morceaux qui attireront le plus l'attention seront sans doute les deux singles, "I Don't Believe in Miracles", composé par Russ Ballard (le guitariste d'Argent), et qui est un peu à cet album ce que le "Say You Don't Mind" était à One Year, et "How Could We Dare To Be Wrong". Cette dernière chanson est absolument magnifique. On est dans un genre assez risqué, la pop pianistique avec arrangements chargés (une batterie et une basse entrent en scène, puis il y a une guitare lead, des choeurs...). Or, rien ne vient entraver la poésie constante créée par la voix de Blunstone ; les instruments se renforcent au lieu de se confronter.
Le plat de résistance de l'album est peut-être la suite de quatre chansons (qui se voit justement attribuer le qualificatif de "quartet") succédant immédiatement à "I Don't Believe in Miracles". "A Sign From Me To You" aurait pu figurer sur Odessey & Oracle, avec sa tonalité mineure mélancolique et avec les mouvements vocaux ascensionnels du refrain - s'interrompant comme s'il y avait brisure. "How Wrong Can One Man Be" : une des plus belles chansons de Blunstone, dominée par la guitare acoustique, avant qu'une basse chaloupée s'invite à la fête. Paul Simon ne l'aurait pas reniée. "Every Sound I Heard" : c'est la chanson de l'album que j'écoute peut-être le plus souvent. On y entend d'exquis pizzicati de cordes enrobant des gracieusetés pianistiques qui évoquent la production mozartienne destinée aux enfants. C'est Chris Gunning qui a arrangé la partie de cordes. Grâce à lui, Ennismore évite l'écueil de la musique symphonique dans lequel les Moody Blues se sont échoués à de multiples reprises, pour se rapprocher de la musique de chambre. "Exclusively For Me", de structure plus simple, accueille des sons de Rhodes parmi les plus beaux qu'il m'ait été donné d'entendre...
Ceux qui aiment ce genre d'atmosphère apprécieront sans doute également "I've Always Had You" : moi qui hais ordinairement les solos de saxophone, j'ai été saisi par la beauté de celui retentit ici de façon inattendue, après plusieurs secondes de silence.
L'album, en son centre, a des titres plus nerveux : "I Want Some More", emmené par une rythmique électrique, "Pay Me Latter", avec sa basse de blues-rock et son bottleneck agité...
Tout s'achève tendrement, avec le très blunestonien "Time's Running Out" (guitare acoustique et voix feutrée de rigueur) puis avec "How I Could We Dare To Be Wrong", qu'on a déjà cité (mais qui méritait la double citation).
1973 ? Qu'y a-t-il eu de si extraordinaire en matière de pop en 1973 pour qu'Ennismore soit aussi mal desservi ?
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Le deuxième classique des Pretties
Publié le 18/08/08

On parle ici d'un groupe qui a rivalisé avec les meilleurs pendant toute une décennie. Les deux premiers albums, proposant (on l'a dit souvent) une version plus sauvage des Rolling Stones, sont aussi denses que n'importe quel album contemporain de la british invasion. Le troisième album, Emotions, n'a pas été épargné par les critiques ; les rééditions, incorporant des versions préservées du fatras orchestral qu'avaient imposé les producteurs, nous permettent toutefois de l'évaluer de façon plus raisonnable (le magnifique "The Sun", avec sa fragile descente de piano). Le quatrième album, c'est SF Sorrow, qu'on ne présente plus : fleuron du psychédélisme, il révélait chez les Pretty Things des capacités mélodiques et harmoniques insoupçonnées (là où les Stones avaient complètement sombré avec Between the Buttons et Their Satanic Majesties Request). Le cinquième album (le dernier avant le split, ou plutôt le premier split) réalise un peu la synthèse de toutes ces tendances : on y voit les Pretties renouer avec un rock parfumé de gimmick blues ; mais l'album s'ouvre et se referme sur des chansons pop, les couleurs psychédéliques n'étant pas oubliées (voir "The Rain").
Ces contrastes sont d'ailleurs reliés au projet même de l'album. Phil May explique que Parachute est né alors que les rêves et idéaux des sixties étaient en train de mourir. "Des gens quittaient la ville et partaient mener une vie purement campagnarde, pour concentrer leurs pensées...". Les Pretties étaient loin des délires de ce genre ; mais l'album reflète les hésitations de l'époque. Album conceptuel, même si la trame narrative est plus lâche que dans SF Sorrow.
La production contribue à donner une unité à l'album : partout règne la même luminosité. Parachute a été produit par Norman Smith dans le studio qui a vu les Beatles accoucher d'Abbey Road : même velouté dans le son, même raffinement qui empêche les chansons les plus rock de tomber dans l'ornière du rock FM mainstream. A ce titre, Parachute est davantage un album des sixties, qu'il referme de façon douce-amère, qu'un album des seventies. On ne louera jamais assez Norman Smith pour l'intelligence dont il a su faire preuve, pour la clarté de sa production (dont Abbey Road avait donné un premier étalon) et aussi pour ses qualités humaines : il a soutenu les projets des Pretties sans jamais faiblir, il les a laissé enregistrer à toute heure de la nuit...
Les réussites sont nombreuses. "Scene One" est à Parachute ce que "Exp" est à Axis : Bold as Love : une plage à visée essentiellement atmosphérique, même si elle comporte des paroles. C'est un condensé de l'album tout entier, qui parvient à faire tenir en deux minutes effets sonores ascendants et inquiétants (très urbains), rythmiques acoustiques, break de batterie, riff électrique, choeurs planants... Le moins surprenant n'est pas de rencontrer un piano au beau milieu de l'apex final.
Le dyptique "The Good Mr. Square" / "She Was Tall, She Was High" : magnifique pop à chanter en choeur. Les Pretties ont retenu l'intelligent mixage de SF Sorrow, avec la basse et la batterie très avant.
"In the Square" est la pièce psychédélique de l'album. La descente harmonique qu'elle propose, ponctuée par les accents troublants du sitar (quand dira-t-on que les Pretty Things ont utilisé cet instrument avec plus de pertinence que tous les autres groupes des sixties, Beatles y compris ?), ne peut pas ne pas avoir influencé Radiohead pour la composition de "Paranoid Android".
La voix de Phil May entre en scène seulement lors du cinquième titre, "The Letter" : preuve supplémentaire du dédain des Pretties pour les considérations commerciales. Chanson tendre, avec un riff de flûte (!), ou plutôt de Mellotron.
Les morceaux qui suivent sont plus durs. L'intro acoustique (avec la basse en élément lead) de "Rain" permet de faire transition avec la chanson précédente, avant que la voix de Wally Waller, dans un registre écorché, ne se déploie. Comme dans SF Sorrow, on est surpris par l'aptitude qu'ont ici les Pretties à superposer les éléments issus du rock et ceux relevant de la pop (les choeurs orgiaques). "Miss Fay Regrets" et "Cries from the Midnight Circus" font admirer les capacités de chanteur de May, dans son registre le plus écorché. La première est propulsée par un riff de guitare incendiaire (il est question d'une chanteuse en déclin : on pense à Sunset Boulevard de Billy Wilder) ; la seconde a un riff étonnant, avec basse descendante. Le riff s'alourdit progressivement, accueillant guitare distordue puis harmonica, suivant en quelque sorte les inflexions de l'atmosphère nocturne évoquée par la chanson. C'est la deuxième chanson la plus longue de l'album, mais les solos n'y sont jamais ennuyeux. Le premier solo est manifestement joué par un Hammond tellement distordu que son timbre se rapproche de celui de la voix humaine ; des accords de piano noyés d'échos résonnent, pendant que l'excellent batteur Skip Allen (qui a remplacé Twink) s'adapte avec une souplesse admirable à toute nuance mélodique. Il ne faut jamais oublier que les Pretties avaient acquis de leurs prestations scéniques légendaires une efficacité qui leur permet d'éviter constamment l'écueil de l'emphase.
"Grass" : chanson électrique comme les précédentes, mais décrite par Phil May comme un "hymne pastoral" (c'est sa chanson préférée sur l'album). A ce titre, elle hérite de la mobilité mélodique typique de la pop et culmine sur des choeurs.
"Sickle Clowns", chanson la plus longue de l'album, s'inspire de la violence de la fin du film Easy Rider : l'utopie hippie s'achève dans les flammes. Façon de montrer que le milieu rural peut être aussi violent que celui de la ville ; pour reprendre le titre de l'album, fuir son environnement ne garantit pas que le "parachute" sera sûr. A noter le caractère modal du premier solo, approprié au propos (mode de vie hippie).
"She's a Lover", amalgamant nature et corps féminin, est un morceau de rock exceptionnel, qui met en valeur les qualités de Skip Allen. A-t-on jamais vu une chanson à la fois aussi rock et aussi subtile harmoniquement parlant ? Sans doute le titre le plus "catchy" de l'album.
Les deux dernières chansons sont ce qui se rapproche le plus, ici, d'Abbey Road. "What's the Use" tout d'abord : une descente de piano modale, puis une douze-cordes "jangly", des choeurs ascendants et le refrain : "What's the Use...". Tout cela tient en moins de deux minutes. "Parachute", surtout, rappelle les Beatles : le chant en choeur, magnifique, lent, "gorgeous" (un peu comme dans "Sun King"), guitare lead lumineuse... Il y a ici une sorte de plénitude mélancolique. Piano, nappes de clavier... Une sirène ascendante conclut l'album comme un accord de piano apocalyptique concluait Sergeant Pepper's.
Aucun amateur de pop digne de ce nom ne saurait sérieusement se passer de cet album. C'est tout simplement le dernier flambeau de la pop anglaise des sixties.
Les chansons proposées en bonus tracks constituent de magnifiques additions à ce corpus pop : "Blues Serge Blues", par exemple, avec ses choeurs, son piano "chantant sur le mode mineur" et ce qu'il faut bien appeler des pizzacati de basse... Mêmes choeurs mélancoliques sur "October 26", qui fête une autre révolution que celle évoquée par le titre : la révolution manquée de ceux qui, dans les années 60, croyaient en quelque chose. "Summertime", c'est aussi de la pop, rehaussée par la guitare flamboyante de Peter Tolson (qui a remplacé avantageusement Vic Unitt après l'enregistrement de Parachute). Dans le registre rock : "Cold Stone" (avec sa belle collection de riffs) et "Stone-Hearted Mama". Wally Waller semble presque désavouer "Stone-Hearted Mama" ; on connaît pourtant peu de groupes qui ne seraient pas enchantés d'avoir à proposer un tel riff. "Circus Mind" : une des chansons les plus émouvantes des Pretty Things, où le chant de Phil, accompagné seulement par des choeurs et par la guitare réverbérée de Peter Tolson, se brise. C'est la dernière chanson que la formation historique des Pretties (celle d'avant la rupture) aura enregistrée.
Est-ce leur versatilité ? leurs cheveux longs ? leur réputation de sauvagerie ? On a du mal à comprendre ce qui a pu maintenir dans l'ombre un groupe tel que les Pretty Things. Parachute, élu album de l'année par Rolling Stone (en une année qui compta quand même After the Gold Rush, Morrison Hotel, Moondance, Layla and Other Assorted Love Songs, Bridge Over Troubled Water...), pourrait fort bien, complété par les singles proposés en bonus tracks, constituer la plus formidable collection de chansons de toute la décade 70.
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Les feels de Brian Wilson
Publié le 21/07/08
La première vérité, c’est que ces « feels » sont harmoniquement fuyants. Brian Wilson, nourri dès sa jeunesse par les harmonies savantes de Burt Bacharach, évite presque consciencieusement la tonique (le premier degré de la gamme). De là peut-être l’impression d’apesanteur qui émanait déjà de Pet Sounds (ça joint à la lenteur des chansons, « Wouldn’t it be Nice » faisant exception).
Un bel exemple : « Don’t Talk (Put Your Head on my Shoulder) ». Le rédacteur de l’article cité, Rob C. Wegman, a tout à fait raison de dire que l’accord de tonique n’est jamais atteint (si ce n’est une fois, à la toute fin du refrain, sous une forme 6/4 qu’on appelle renversée, ce qui n’apporte aucune impression de résolution). Il se trompe cependant dans le chiffrage des accords du couplet : il faut considérer ici que la tonique est Sib, la tonalité modulant ensuite sous l’effet des chromatismes.
La même pratique se retrouve dans Smile : « Cabinessence » en est un bon exemple. La tonique n’est touchée que lors du refrain, qui est harmoniquement d’une simplicité presque outrancière (avec deux accords). On remarquera en passant que cette dichotomie entre couplets et refrain se retrouve dans d’autres chansons de l’époque, en particulier dans « Heroes and Villains », « Good Vibrations » semblant en avoir marqué la naissance (cette chanson fait décidément transition entre Pet Sounds, dont elle a la simplicité de mots - on retrouve le jeu de mots « close » / « closer » - et les structures fragmentaires de Smile). Tout se passe comme si Brian Wilson ne voulait pas choisir entre la sophistication de la pop et l’allégresse du rock primal - qu’il avait célébrée, ainsi que le mode de vie californien, dans les premières années des Beach Boys.
Deuxième vérité soulignée dans cet article : le fait que le mixage et les arrangements estompent bien souvent la structure harmonique pour mettre en avant les contre-chants ou les contrepoints instrumentaux. C’est cet obscurcissement qui donne aux arrangements de Brian leur clarté paradoxale. Une belle leçon... Les lignes de basse très mobiles contribuent à laisser dans l’ombre la basse des accords et donc les accords eux-mêmes.
Troisième et dernière vérité : le fait que Brian ait poussé sa logique du fragment à un point extrême, pathologique, pour Smile. J’ai souvenir d’avoir été très surpris, quand j’ai entendu pour la première fois le refrain de « Heroes and Villains ». Il y avait, dans la simplicité harmonique du refrain (des oscillations entre deux accords) compensée par l’espèce de pointillisme à l’œuvre dans les chœurs, quelque chose de quasiment pathologique. Je viens de le réécouter et cette tapisserie de notes me fascine toujours autant...
Si la matière travaillée par Brian Wilson, à l’époque de Brian Wilson, s’est réduite au fragment (alors que les chansons de Pet Sounds restaient encore compactes : penser à « God Only Knows »), c’est parce qu’un refus extrême de la tonique produit nécessairement du non-fini. Soyons honnêtes : ce qu’observe Rob C. Wegman, c’est un phénomène récurrent dans la musique de Brian, mais pas systématique. En cherchant bien, on trouvera évidemment des toniques. Néanmoins la tendance est là ; elle est très forte et participe d’un phénomène plus général : Brian n’aime pas conclure. Il faut se rappeler que plusieurs de ses chansons de la grande époque se terminent de la même façon : par un motif clos sur lui-même et répété. Exemples : « Don’t Talk », « God Only Knows », plus tard « ‘Til I Die »...
Les choix qui s’offrent à celui fuyant la résolution d’un fragment musical sont les suivants :
1) Interrompre un fragment pour l’enchaîner à un autre. C’est ce que fait Brian dans plusieurs chansons de Smile. Le refrain de « Cabinessence » (qui apporte la tonique tant attendue) intervient brutalement et est de nature très différente du couplet. Même constat pour la deuxième section de « Wind Chimes », où la basse (même motif) apporte néanmoins un élément de continuité. Apparaît alors une autre caractéristique de Smile : ses fragments se répondent parfois, en ayant un ou deux éléments communs, constituant au final un gigantesque jeu de construction.
2) Interrompre brutalement un fragment, en donnant à la chanson qui suit une fonction résolutive. « Roll Plymouth Rock » s’achève de façon insatisfaisante ; c’est « Banyard » qui vient en quelque sorte lui apporter une tonique résolutive.
3) Répéter un fragment à l’infini (ou presque). « Barnyard », dont on vient de parler, est d’une anormale simplicité, avec ses deux accords répétés, auxquels seul le passage à la plage suivante met un terme. Les extraits les plus courts de Smile qui ont été retenus pour Smiley Smile ou qui ont été composés à la même époque ont presque tous cette caractéristique : ils se constituent d’une cellule de deux ou trois accords répétés obsessionnellement, et n’ayant pas de fin (un fade out vient conclure la chanson). C’est la raison pour laquelle je pense que Smiley Smile n’est pas aussi mauvais qu’on a bien voulu le dire. Des morceaux (je préfère décidément les appeler ainsi plutôt que d’employer le terme de « chanson ») comme « Getting Hungry » et surtout « Whistle in » peuvent être très troublants...
Le corollaire de cette pratique : lors de l’élaboration fiévreuse de Smile, avant que la dépression ne ruine en lui toute ambition, Brian Wilson avait renoncé à l’idée de chanson (la chanson traditionnelle, avec son couplet et son refrain aussi soudés que possible). On l’imagine répétant de façon lancinante, sur le piano qu’il avait installé dans son bac à sable, ses « feels »... Que Brian les ait qualifiés de « rythmiques » n’est d’ailleurs peut-être pas aussi aberrant que le pense Wegman : nous n’avons pas affaire à des riffs, certes, mais néanmoins à quelque chose d’ « extrêmement rythmique » au sens que lui donnait Verlaine. Qu’on pense au motif « Bicycle Rider » joué sur une boîte à musique, à « Fire », au travail sur les timbales...
Il est assez touchant de songer que cette fragmentation de la forme puisse être en rapport avec une fragmentation de l’esprit. Le poète Georg Trakl évoquait fin 1913 un « monde qui se brise » (« entzweibricht ») ; peu de temps après apparaissaient des poèmes à l’écriture très fragmentaire et heurtée (les hymnes « Abenland » et « Passion », sans même parler des derniers poèmes). Robert Walser, diagnostiqué schizophrène, écrivit pendant des années, avant de mourir, des fragments rédigés dans une écriture minuscule et très difficilement déchiffrable...
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Smile et l'Americana
Publié le 22/06/08
Brian voulait que son nouvel opus soit spécifiquement américain (Pet Sounds se ressentant en partie de la compétition entamée avec les Beatles). De fait, ce qui constitue l'actuelle première partie de Smile est une compilation des images les plus belles (et parfois les plus naïves) de l'Americana : l'exode initiatique ("Heroes and villains"), la culture de la terre ("Barnyard"), la construction des chemins de fer ("Cabin Essence")...
L'ambition démesurée de Wilson ne pouvait être accomplie que par une simplification de l'histoire américaine : autrement dit par une abstraction. C'est peu dire, justement, que les paroles de Van Dyke Parks sont abstraites... Ce que la vapeur apporte aux îles Hawaii, dans ce grand voyage de côte à côte qu'est "Roll Plymouth Rock", c'est la "structure sociale"...
La caractère très imagé de ces paroles concourt pour une part non négligeable à la réussite de Smile : il y a mimétisme entre la musique fragmentée, "modulaire" (pour reprendre le terme de Brian), et les paroles, avec leur point de vue sans cesse changeant. L'ubiquité est celle dont se prévaut le héros jaggerien de "Sympathy for the Devil", mais à un degré bien plus irréaliste.
A propos de cette fragmentation, il me paraît utile de rappeler que lors de l'abandon de Smile, au printemps 67, plusieurs morceaux avaient encore une structure incertaine. Le seul "Heroes and Villains" avait connu des dizaines de mixages différents : Brian lui a a d'abord adjoint le segment "Bicycle Rider", initialement prévu pour "Do You Like Worms", puis a élaboré le segment dit "Cantina", a créé maints petits fragments finalement rejetés (et dont certains, comme "Whistle in", échoueront sur Smiley Smile)... Smile a complètement dissous les frontières entre chansons pour les fondre dans un ensemble kaléidoscopique et sans cesse mouvant.
Le fait que des fragments de la culture américaine aient été inclus dans Smile (au prix parfois d'altérations de leur caractère : ainsi "You Are My Sunshine" prend un tour particulièrement mélancolique) a été rattaché par certains à un flashback de LSD au cours duquel Brian Wilson avait vu les titres des livres qu'il consultait dans une bibliothèque s'affaissaient peu à peu, se fondaient l'un dans l'autre... La fin de "You Are My Sunshine", où tout l'orchestre est la proie d'un glissando, pourrait décrire musicalement ce phénomène. (L'inclusion de "You Are My Sunshine" me rappelle personnellement le film O'Brother qui, comme Smile, constitue une sorte d'épopée initiatique à travers les USA.)
Le segment "Bicycle Rider" est capital dans l'articulation de Smile : c'est lui qui place l'ensemble de l'oeuvre sous le signe de l'innocence perdue (thème cher à Brian, puisqu'il l'avait déjà effleuré avec Pet Sounds). Il annonce le passage de la phylogenèse de la première partie à l'ontogenèse de la seconde (celle consacrée à l'enfance).
Cette seconde partie est évidemment à mettre en rapport avec l'enfance difficile de Brian, marquée par ses rapports avec un père violent et tyrannique. La biographie de Brian rappelle qu'en décembre 65, à la suite de l'ingestion d'une forte dose de LSD, il s'était vu pris dans les flammes, régressant, retournant peu à peu en enfance... La citation de Wordsworth, "Child is Father of the Man", procède sans doute de ce trip voire du suivant : une autre prise de LSD, près du lac Arrowhead (jadis haut lieu de la culture indienne), en avril 66, avait en effet été l'occasion d'une "ultimate religious experience" dont Brian parlerait plus tard. Ce trip-ci semble avoir été traversé de visions de pluie et d'eau...
La dernière et ultime partie de Smile était en germe dans ces hallucinations : le feu et l'eau. Brian s'intéressait à l'époque au bouddhisme zen, à la disparition de l'ego (à la fin de son trip régressif, il n'existait plus : "And then, finally, I was gone. I didn't exist."), à la fusion avec les éléments. Logiquement, le voyage se conclut à Hawaii, qu'on peut relier aux trois thèmes de l'oeuvre :
- conclusion du voyage d'est en ouest à travers les Etats-Unis
- lieu associé, dans la Californie de l'époque, au bouddhisme et à la méditation (voir, pour en être convaincu, la trajectoire de Merrel Fankhauser)
- aboutissement du parcours initiatique ; ce n'est que par la disparition de l'ego (Harrison : "I Me Mine") que l'oubli des souillures et la réconciliation peuvent advenir.
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Le danger du style
Publié le 28/05/08
Tel groupe va construire toutes ses chansons sur des alternances entre passages instrumentaux fleuris et refrains propres à susciter un pogo ; tel autre groupe va plagier systématiquement les sons électroniques des derniers Radiohead sans jamais se rendre compte qu'il passe à côté du meilleur chez Thom Yorke et Radiohead (les qualités harmoniques du pourtant très électronique "Analyse", etc.).
Cette espèce de spécialisation est bien dans l'esprit de l'époque, qui exige de la lisibilité, qui aime, dans toutes les disciplines artistiques, la catégorisation en genres.
Il me semble que dans les années 60, l'obsession du style musical était moindre... Quid du double blanc des Beatles ? Les effluves psychédéliques ("Dear Prudence") y côtoient les ballades folk ("Julia"), les morceaux de hard rock ("Helter Skelter"), les collages expérimentaux ("Revolution 9"), les berceuses orchestrales ("Good Night")...
Il y a un songwriting compact et efficace, chez les Beatles, mais il n'y a pas de style bien définissable. Ou plutôt, ce qu'on appelle style n'intervient que comme corollaire de l'essence de la chanson, à savoir l'émotion qu'elle a à transmettre.
On retrouve cette belle diversité chez des groupes qui font déjà figure de classiques. Je parlais de Radiohead... Quoi de commun entre le grunge des débuts ("Creep"), les ballades ("Fake Plastic Trees"), les morceaux épiques étirés comme à l'époque progressive ("Paranoid Android"), le folk ("True Love Waits"), les appropriations du jazz Nouvelle-Orléans et du free-jazz que constituent "Life in a Glasshouse" et "National Anthem", les expérimentations technoïdes les plus récentes ?
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
The Soft Parade : pas si mal que ça !
Publié le 05/02/08
C'est pourtant sur Waiting for the Sun que l'on rencontre les chansons les plus simplement belles et touchantes des Doors : "Summer's Almost Gone", "Love Street", "Wintertime Love", "River Knows"... J'ai déjà défendu cet album dans une notice de la rubrique "Essentiels". Du reste, je crois qu'il a moins besoin d'être défendu que son successeur, The Soft Parade, qui se fait régulièrement descendre en flammes du fait de sa production pompeuse. Le "moins bon album des Doors", ai-je pu lire assez souvent..

Le moins bon album des Doors, The Soft Parade l'est certainement... Mais il mérite mieux que du dédain. On parle quand même des Doors, bon sang ! Cet album contient la mini-suite la plus construite que les Doors aient jamais réalisée (la chanson-titre, peut-être meilleure que "The End" ou "When the Music's Over"). "Wishful Sinful" : belle chanson mélancolique...
Mon but n'étant pas ici de lister toutes les chansons de l'album, je m'attarderai en détail sur une seule d'entre elles, "Shaman's Blues", peut-être la plus grande réussite de tout le répertoire des Doors.
L'introduction est spectaculaire : un glissando de Hammond s'effondre sur une note abyssale jouée sur le fameux Fender Bass de Manzarek. La profondeur est celle de l'inoubliable "Don't Talk" de Brian Wilson.
La batterie : elle a le swing habituel à Densmore (et qui manque tant aux batteurs de rock d'aujourd'hui)... Mais il faut surtout écouter la façon dont ont été mixées les cymbales : en avant, avec de la réverb. Effet de transe garanti.
La mesure ? C'est une valse, mais une valse boiteuse : seul le deuxième temps est marqué... et quand arrive la basse, le déséquilibre devient total : cette ligne de basse, spontanément, serait jouée à deux temps par la plupart d'entre nous. Essayez de faire la battue, à la main, et je suis sûr que vous en conviendrez... Les deux dernières notes de la ligne devraient être comptées "un" et "deux"...
Le riff de basse sera répété obsessionnellement tout au long de la chanson, un peu comme dans une passacaille, renforcé par le Hammond et par la guitare de Krieger (éclatante, pleine du sustain de la SG, frisant toujous la saturation), qui ne reproduit pas exactement le motif de Hammond mais qui s'en rapproche très fortement.
Valse ? Passacaille ? C'est aussi au blues, qu'il faut se référer : la grille harmonique le rappelle bien évidemment, avec la montée classique à la sous-dominante... Pourtant, ce n'est pas exactement une grille de blues.
Cette chanson est éminemment doorsienne : Morrison chante dans son plus pur registre de baryton, concluant la chanson par des segments mi-parlés ad lib ; le son de l'orgue de Manzarek tire sur celui du Clavinet un peu comme dans "Wintertime Love" ; le solo de Krieger est sale (voir comment il démarre, à 2:30) et lumineux ; les paroles convoquent le shamanisme...
Ce n'est décidémment pas le produit d'un groupe en déclin. Ce qui me convainc que les Doors, en 1969, étaient à l'apogée de leur potentiel créatif, ce sont les bonus tracks proposés dans la réédition du 40ème anniversaire. "Whiskey, Mystics and Men", une chanson de marin, comme Morrison avait toujours voulu en faire (la marque du père ?), bénéficie d'arrangements magnifiques. Et "Who Scared You", sortie en face B de "Wishful Sinful", est une forme de blues psychédélique, à l'instar de "Shaman's Blues" (même si moins brillante, naturellement).
Bref, après 1969, les Doors produiront deux disques très influencés par le blues ; mais l'ambition psychédélique sera mise de coté. En partie dans Morrison Hotel (rehaussé par le splendide "Waiting for the Sun", datant - ne l'oublions pas - de sessions de 1968). Totalement dans L.A. Woman (qui, s'il contient des pépites, comme tout disque des Doors, est à mon sens surfait en raison de sa valeur historique - le dernier album avant la mort de Morrison).
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
The Auteurs : la suite !
Publié le 04/01/08
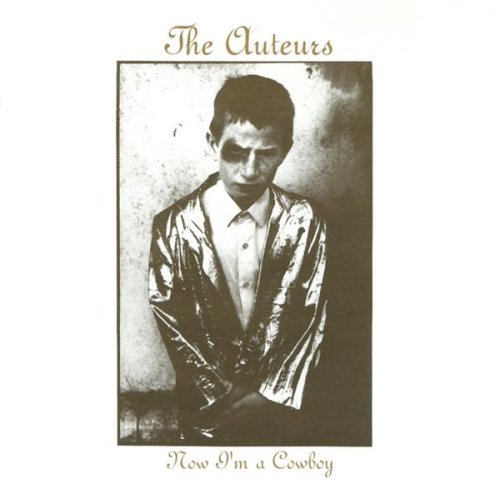
Je lis partout que le deuxième album des Auteurs serait décevant... parce qu'il ressemblerait au premier. De fait, Luke Haines ne change rien à ses méthodes pour Now I'm A Cowboy. Qu'aurait-il dû faire ? Il sait écrire des chansons, là où ses contemporains en sont bien souvent incapables ; aurait-il dû y renoncer pour produire, comme eux, une bouillie - mais une bouillie saupoudrée de style ?
Je crains fort que certains aient osé disqualifier le groupe pour de simples accointances supposées avec le glam. Certaines entrées en scène de la guitare saturée peuvent effectivement rappeler les arrangements de Mick Ronson ; mais on s'accommode fort bien de ce genre de déshonneur, il me semble !
De toutes les façons, les variations d'intensité qui traversent nombre de ces chansons (et leur donnent une dynamique constante) sont sans doute autant tributaires du grunge récent que du glam. Si Luke Haines a repris quelque chose du glam, ce n'est pas le maniérisme ; tout au plus le bellicisme anti-bourgeois. La décadence qu'il chante, il ne s'y vautre pas ; il la met à distance et la contemple insolemment, un verre de gin à la main. On parle quand même d'un terroriste du rock, pas d'une pute !
Luke Haines est un arrangeur d'exception. Il faut écouter une chanson comme "Chinese Bakery", où les guitares saturées laissent place, sans aucun hiatus, à un violoncelle et à une guitare jangly... Qu'on ne s'y trompe pas : jamais de mièvrerie ici. Les cordes se font instruments riffeurs ("Underground Movies") ; le piano devient un instrument percussif à une note ("Lenny Valentino", incontestablement la chanson la plus célèbre de l'album).
Il m'est arrivé de m'éveiller, d'entendre les sons de Luke Haines (soit énervés soit apaisés) et de m'étonner de la beauté avec laquelle ils résonnaient... Il faut aussi créditer son groupe pour cette performance ; il y a dans les couplets d'"I'm a Rich Man's Toy" une sorte de swing délicat qui n'est pas à la portée de toutes les sections rythmiques de la terre.
Quelques longueurs inutiles à la fin de "Modern History" : c'est tout ce qu'on peut reprocher à Now I'm a Cowboy, quand on le compare à New Wave.
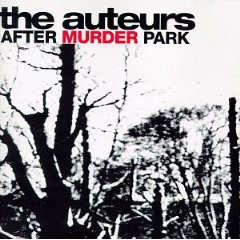
After Murder Park, qui jouit d'une cote critique sûrement meilleure que son prédecesseur, a été produit par Steve Albini. Le son, comme on peut s'y attendre, est plus dur. La guitare lead a moins de réverb mais est plus saturée. Pour le reste, le fossé entre les deux albums n'est pas aussi grand qu'on a bien voulu le dire...
Luke Haines continue à mêler à sa sauce guitaristique claviers (Hammond notamment) et cordes (le violoncelle de James Banbury). Les chansons lentes ont toujours ce charme vénéneux qui tient pour une bonne part au timbre aigre de la voix de Haines. Il passe généralement bien plus d'air que de son à travers le larynx de cet homme-là ! On aimerait en savoir plus sur sa connaissance de la musique psychédélique (voir la fin de "New Brat in Town" ou le début de "Dead Sea Navigators")...
Le disque s'achève sur un quarté très solide, avec "Buddha" comme chef d'oeuvre : "Happy birthday brotheeer...".
Les Auteurs ont été incomparablement meilleurs que leurs rivaux de la Britpop, à commencer par Blur et Oasis. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux. Comment faire de la power pop, c'est-à-dire une musique représentant un compromis intéressant entre la mélodie et l'impératif scénique de la puissance, sans tomber dans le mauvais goût ? Comment intégrer totalement une guitare lead à la structure d'une chanson (à la manière du Joey Santiago des meilleures années) ?
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Richard Hell & the Voivoids
Publié le 20/12/07
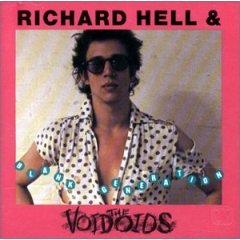
Qu'est-ce qui rend Richard Hell incontournable ?
C’est d’abord un personnage historiquement important. Il a été le complice de Tom Verlaine, avec qui il a publié un recueil de poésie, co-fondant ensuite Television. Tout laisse à penser que c'est lui qui a été l'initiateur du style de chant étranglé, à la fois désinvolte et insolent, qu'on associe à Tom Verlaine. Hell a aussi été l'initiateur du look punk : cheveux en crête coupés au sécateur, tee-shirt déchiré, épingles à nourrice... En le voyant, Malcolm McLaren lui proposera aussitôt de devenir le leader d'un groupe qu'il voulait mener au sommet (les Sex Pistols) ; Hell déclinera, mais McLaren n'oubliera rien de ce qui l'avait frappé chez Hell. On connaît la suite...
Mis à l'écart de Television, il co-fondera les Heartbreakers avec Johnny Thunders, autre grande figure new-yorkaise. Sa présence scénique étant décidément difficile à supporter, il s'en ira pour fonder les Voidoids, réussissant enfin à graver quelques-unes des chansons qu'il avait en stock.
La vogue punk étant passée, Richard Hell, qui n'est pas un abruti et qui a toujours eu du recul sur ce qu'il faisait, contribuera à la vie intellectuelle new-yorkaise par des romans (bien accueillis), des critiques de cinéma, etc.
Que dire de la musique ?
La musique des Voidoids est moins sophistiquée que celle de Television (donc peut-être aussi plus accessible) ; bien au-dessus des bouffonneries navrantes des Ramones.
Les Voidoids bénéficient du style de chant de Hell, dont on a déjà dit un mot, mais aussi du jeu de guitare de Robert Quine, sûrement le guitariste le plus virtuose à être passé par le punk. Quine avait été séduit par le charisme de Hell et avait accepté de rejoindre le groupe, alors même qu'il était plus âgé et que sa philosophie de vie - à l'origine - ne cadrait pas tout à fait avec l'anarchie hellienne. Quine, par la suite, est resté fidèle à Hell jusqu'au bout (c’est à l'image des nombreuses dévotions que Hell a pu susciter, parmi lesquelles il faudrait citer la regrettée Lizzy Mercier-Descloux, a quitté Hell a rendu hommage après son décès).
Quelques points forts de l'album :
- "Blank Generation" : hymne du punk new-yorkais, cette chanson a été élaborée et traînée par Hell bien avant son enregistrement définitif par les Voidoids. Son apparent nihilisme est à modérer, selon les propos mêmes de Hell, qui expliquait avoir voulu fêter la vie libre de ceux qu'il envisageait comme les murs blancs des lofts new-yorkais : des tabulae rasae pour qui tout serait à écrire, à l'inverse de produits déjà labelisés par la société.
- "Love Comes in Spurts" (l'amour vient en jets !)
- "Liars Beware" : une formidable chanson punk emmenée par un riff de guitare/basse frénétique. Hell : "Ridiculous people, you lose your teeeeeeeeth...".
- "Betrayal Takes Two" : ce titre me paraît assez intéressant, en ce qu'il montre comment, même quand le rythme est lent, les Voidoids parviennent à éviter l'évidence sucrée, grâce notamment au jeu de Robert Quine, qui frotte obsessivement ses single notes à la Neil Young (mais en bien plus inspiré), qui flingue les gammes par des chromatismes acides, qui "bruite", anticipant presque Sonic Youth...
- "I'm Your Man" : elle ne fait pas partie de la set-list de l'album, mais est heureusement proposée en bonus track. C'est une chanson pop/rock, avec chœurs répondant au chanteur (comme dans le rock le plus classique ; qu'on pense à "What's Good for the Goose" des Pretty Things). Richard Hell chante mieux ici mieux que jamais, avec un soupçon de misogynie et une arrogance délectable...
- "The Plan" : une autre chanson éloignée des canons du punk, avec chœurs... On pense à Television (du fait de la guitare presque arpégée).
Le point faible de l'album : "Another World", chanson la plus complexe de l'album d'un point de vue rythmique, et pour le coup rappelant franchement Television, est évidemment trop longue (près de 9 minutes). Les Voidoids étaient techniquement supérieurs à la moyenne des groupes punk, mais n'avaient pas nécessairement les moyens de développer une chanson au-delà de 5 minutes comme Tom Verlaine et Richard Lloyd en étaient capables. "All the Way", cover de Frank Sinatra, semble avoir été enregistrée avec des intentions parodiques : ce bonus track apparaît également dispensable.
Les Voidoids enregistront en 1979 une suite à cet excellent album. Mais sans surprise, Destiny Street est moins bon. On ne peut pas, en menant la vie que menait Hell, rester longtemps concentré à 100% sur la musique. Et puis, le punk, ce n'est pas 79 ; c'est 77 (comme 67 avait été l'année de la pop).
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Mercury Rev : vive le mellotron !
Publié le 27/11/07

L'ouverture ("Holes") est parfaite : cordes, nappes rêveuses de mellotron, puis la voix haut perchée et un peu aigre de Donahue s'élève : "Intro a dream...". "Tonite it Shows" est dans la même veine (et peut-être encore plus suggestive, avec ses pizzicati et son glockenspiel), de même que "Endlessly".
Ceux qui comparaient la musique de Mercury Rev au rock symphonique (avec tout ce que ça sous-entend de pompeux) oublient manifestement que ce qui donne sa couleur à l'album, c'est avant tout le mellotron, le mellotron qui, dans le "Hang up on a Dream" des Zombies, donnait forme musicale au monde du rêve. Que faisaient les Moody Blues, eux, si ce n'est remplacer au maximum le mellotron par un orchestre véritable ?
Le single "Goddess on a Hiway" ne dépare pas au milieu de tout cet ensemble, pas plus que "Opus 40" (qui convoque le Hammond B3 des sixties) ni que "The Funny Bird", où la voix de Donahue est très fortement distordue (on pense à Sparklehorse) et où des cuivres résonnent comme perdus dans quelque forêt ; seuls Robert Wyatt et Mark Hollis sur Laughing Stock ont jamais utilisé ainsi les cuivres. Le saxophone de "Hudson Line" aurait pu détoner ; il n'en est rien.
Une bonne idée : les plages instrumentales en low-fi qui ponctuent les grandes chansons et offrent une respiration. "It Collects Coins", avec son vieux piano, craque comme un vinyle de juke-box, rappelant les expérimentations de Randy California. "Pick If You're There", avec son Rhodes, annonce le Radiohead de Kid A. Les amateurs de modernisme goûteront par ailleurs les sons empruntés à la musique concrète qu'on trouve à la fin de "The Happy End (The Drunk Room)", la scie musicale de Jack Nitzsche qui retentit en diverses occasions, ainsi que le "Tettix Wave Accumulator", un instrument singulier que Donahue et "Grasshopper" ont construit de leurs propres mains.
La réussite de cet album est aussi celle de Dave Friedman, ancien membre du groupe passé à la production. Longtemps je me suis demandé qui avait été responsable de cet élargissement incroyable du son de Mercury Rev. Je pense maintenant savoir...
Au final, le seul vrai ratage dans cet album, c'est le dernier titre, "Delta Sun Bottleneck Stomp", écrit par Jimy Chambers, et inexplicablement choisi comme second single. On vieux bien d'un stomp ; mais substituer au pied qui claque le beat de la house est d'un mauvais goût évident...
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.
Luke, ou comment faire retomber un soufflé plus vite que son ombre
Publié le 03/10/07
Le précédent album de Luke, La Tête en arrière, contenait quelques chansons dont l'énergie ne gâtait pas les mélodies, ce qui, joint à la prestance scénique évidente de Thomas Boulard, avait pu faire croire à l'émergence d'un vrai groupe de rock français (je ne parle pas de la "nouvelle chanson française").
Ce cru 2007, Les Enfants de Saturne, est de ceux qui suscitent la perplexité. On a tout d'abord l'impression d'entendre un quelconque groupe à guitares. L'ennuyeux, c'est que cette impression persiste au fil des écoutes et ne s'efface jamais. Thomas Boulard minaude, couine ridiculement. Je lis que le tranchant des guitares est inédit (dans le domaine francophone). Ce n'est, hélas, soutenu par aucune vision, et c'est donc tout à fait vain. Tout aussi inutile que ce que le rock a produit de pire, Blind 182 par exemple.
Luke est et restera un épigone de Noir Désir, ce dont témoignent quelques paroles mémorables :
Je suis la fièvre, je suis Cuba
Le pilote de F1 Jacques Villeneuve avait un jour accusé son coéquipier Ricardo Zonta de piloter "au-dessus de ses moyens". Thomas Boulard, lui, écrit au-dessus de ses moyens. C'est pénible...
Classé dans | Pas de commentaires
D.B.

|
|